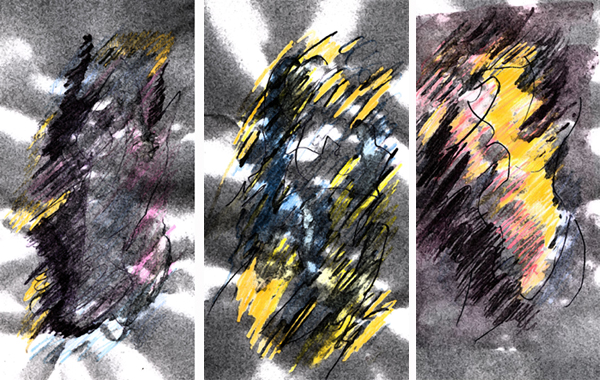Philippe Pujas
L’ÂNE ET LE COQ, OU COMMENT IL EST PROUVÉ QUE LE PROGRÈS TOURNE EN ROND
J’ai arrêté le Progrès. Oh, pas tout seul, bien sûr ; ça aurait été impossible. Je le sais depuis longtemps : j’étais tout enfant quand j’entendais raconter, en famille, l’histoire de ce cousin de ma grand-mère, instituteur qui avait été le seul à observer une consigne de grève. D’après ce que j’en avais appris, la suite de sa carrière en avait été salement affectée ; il faut croire que la très républicaine école de la III ème République ne plaisantait pas avec l’ordre. Donc, quand j’ai arrêté le Progrès, je n’étais pas seul. La quasi-totalité de la rédaction, les ouvriers de la fabrication observaient ensemble une grève assez dure. Ce n’est qu’après que j’ai compris que nous vivions les derniers soubresauts d’une grande aventure. Le Progrès, grand quotidien lyonnais, trônait encore au milieu de la ville, observant, depuis l’angle de la rue de la République, les vastes étendues de la place Bellecour. Nous vivions alors dans un costume trop grand, la plupart des services ayant été déplacés vers la banlieue. Nous occupions des locaux qu’on dirait aujourd’hui non fonctionnels, avec des plafonds trop hauts, de la place perdue à vous donner des frissons d’aise, et des couches de poussière qui vous faisaient sentir le poids de l’Histoire. Aujourd’hui, la FNAC a pris la place du Progrès : mieux vaut faire commerce de biens culturels que d’information, par les temps qui traînent : autre forme du progrès, sans doute... Cela sentait la fin, mais nous ne voulions pas le savoir. Nous étions au contraire pleins d’envies, de projets, de plans pour refaire le monde. C’est toujours comme ça dans les entre-deux, paraît-il. Bref, le Progrès s’essoufflait, respirait comme le font les vieux, mais notre jeunesse l’ignorait. Et pourtant, l’âge était là. Le Progrès datait, et dans son titre, pour commencer. Le Progrès, cela fleurait son XIXème siècle, quand ce mot était porteur d’un avenir radieux. La révolution industrielle triomphait, Monsieur Germain créait le Crédit Lyonnais : la puissance économique alliait la machine et la finance mais, déjà, la finance était la plus forte. Qui se souciait encore des canuts, casseurs de machines et de progrès ? On les avait matés et remplacés. Le progrès, pourtant, n’était pas un bloc univoque. Il portait en lui, simultanément, les ravages de la destruction et l’espoir d’une vie meilleure. La ligne de partage était ce qu’on voulait faire du progrès : enrichir les bourgeois, ou répartir équitablement, comme on disait aux temps oubliés des trente glorieuses du XXème siècle, les fruits de la croissance ? Né en 1868, le Progrès de Lyon choisit le bon versant : il est du côté de la justice sociale, comme nous le serons un peu plus d’un siècle plus tard, fidèles à son esprit. Quand naît Le Progrès, voilà une bonne quinzaine d’années déjà que ce pauvre Paul Chenavard s’est vu refuser son projet de décoration du Panthéon. La commande lui avait été passée par la progressiste et éphémère République de 1848, elle lui sera retirée par le Second Empire débutant, quand le Panthéon reviendra quelque temps à sa vocation religieuse : plus question alors d’y intégrer les élucubrations plus ou moins païennes ou syncrétiques d’un Chenavard. Quand reviendra l’idée de décorer le Panthéon, c’est un groupe d’artistes qui sera choisi, et parmi eux un autre peintre lyonnais, Pierre Puvis de Chavannes. Plus lisse, plus décoratif que Chenavard. Paul Chenavard est un homme de son temps, c’est-à-dire plein des ambiguïtés du progrès. Il est fou d’idées, au point que son ami Théophile Gautier parlera de lui comme d’un peintre qui ne peint pas. A Paris, on le voit plus souvent dans les salons où l’on parle que dans ceux où on expose ; il a la réputation d’un causeur sans égal. Que dit-il ? ce que sa peinture exprimera aussi, mais la peinture se méfie des beaux parleurs et de la philosophie. L’œuvre maîtresse de Chenavard s’appelle Divina Tragedia, et fut présentée à Paris au salon de 1869. Elle se trouve dans ce triste conservatoire du XIXème siècle qu’est le musée d’Orsay. Mais inutile de la chercher dans le dédale confus des cimaises : elle ne s’y trouve pas. Les conservateurs ne l’ont pas jugée digne d’y figurer, et elle dort dans les réserves. Faut-il s’en étonner ? Même pas. L’erreur est humaine, et les conservateurs de musées sont plus humains que la moyenne. Mais en outre, il faut bien constater que Chenavard continue d’être aujourd’hui le mal-aimé des institutions qu’il fut en son siècle. Alors, Divina Tragedia fut jugée confuse dans son propos : rançon d’une peinture qui veut beaucoup dire et ne parvient pas à se faire comprendre. Il faut revenir à l’épisode central de la vie de Chenavard, son projet pour le Panthéon.
Ce qu’il a pu en réaliser il n’a cessé d’y travailler - est à proprement parler monumental : 18 grisailles sur toiles (appelées "cartons"), des dessins, une grande peinture sur le thème de "la philosophie de l’Histoire". Mais ces cartons non plus n’ont pas eu de chance. Installés au musée de Lyon dans les dernières années de la vie de Chenavard, ils en étaient retirés en 1901, six ans seulement après sa mort (quelques-uns restent exposés aujourd’hui). Sa ville natale était bien ingrate avec celui qui lui avait légué sa collection, non seulement ses œuvres, mais les peintures qui avaient alimenté sa création, comme la superbe "Mort de Lucrèce" de Guido Cagnacci, qui fit il y a quelques années la couverture d’un beau livre sur les peintures des musées de France. Pour le Panthéon, Chenavard avait mis en scène ses idées sur l’évolution du monde. En fait de progrès, il y est question d’éternel retour, de palingénésie : la roue de l’histoire plutôt que la flèche du temps... Des idées à vrai dire largement répandues entre 1830 et 1850, et qui s’expriment tout spécialement dans ce qui devait être la composition centrale, "La philosophie de l’Histoire", un triptyque représentant le passé, le présent et l’avenir. Chenavard a bien peint le passé et le présent, mais l’Avenir n’existe pas, et le peu qu’il a laissé des travaux préparatoires dépeint un futur horrible, avec descente aux enfers, et l’impression pénible est à peine atténuée par la présence d’ un phénix porteur de renaissance. Plusieurs explications à cela : la désillusion d’avoir vu sombrer les idéaux de la Révolution de 1848, et ses utopies, en même temps que son grand projet devait être abandonné. Mais, quand même, Chenavard nous met devant la seule certitude qui reste à chacun sur l’avenir ultime : la fin de l’espèce humaine, celle de la Terre elle-même. Quel espoir reste-t-il, sinon celui d’une rédemption après la Chute ? c’est cet avenir que nous propose Chenavard, le seul progrès durable imaginable. Tout cela n’est pas très gai, et on comprend que Puvis de Chavannes ait eu plus de chance que Chenavard, lui qui proposait des scènes antiques ou champêtres plus reposantes, alors que Chenavard avait repris le thème en trois temps de sa Philosophie de l’Histoire. Ce serait donc là le vrai progrès, le retour aux paisibles bonheurs dans les clairières ou auprès des sources et fontaines ? Il est frappant de constater que Puvis de Chavannes a été aussi préféré à Chenavard pour le décor de l’escalier du musée des beaux-arts d’Amiens. Dont il fut question, un temps, pour abriter les cartons de Chenavard pour le Panthéon, et qui compte dans ses collections une "Allégorie de la vanité" de Cagnacci, proche de la Lucrèce de Lyon... Amiens était alors la ville dont l’adjoint à l’urbanisme et à la culture s’appelait Jules Verne, qui avait une tout autre conception du progrès. Mais comment ne pas penser que les deux hommes, Paul Chenavard et Jules Verne, illustrent les deux versants du progrès, l’utopie technicienne et l’utopie métaphysique ? L’avenir devait, en somme, donner raison aux deux : la technique a produit ses machines, la pensée ses catastrophes... Alors, rejeter les deux en bloc ? La technique, baptisée aujourd’hui nouvelles technologies, et la pensée ? ou bien voir ce qui peut être leur défaut commun, le danger de tourner à vide, sur soi, sans considération pour des finalités humaines concrètes ?
Au fond, le progrès, c’est peut-être comme les idées : les majuscules ne lui vont pas bien. Mieux vaut s’appuyer sur une multitude de petits cailloux que sur un gros rocher. Un qui le savait bien, c’est le Petit Poucet, qui a pu progresser au ras du sol, discrètement, sans se faire remarquer... Il nous reste donc, loin des montagnes, des monolithes de grandes idées, à semer nos petits cailloux sur la route du progrès. Laissons-en donc tomber, mine de rien, quelques-uns, que nous laisserons ramasser par qui voudra bien le faire :
 que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
 que plus jamais un Bush ne soit Président des États-Unis
que plus jamais un Bush ne soit Président des États-Unis
 que Dieu arrête de se prendre pour Lui, et qu’on arrête de croire en Lui
que Dieu arrête de se prendre pour Lui, et qu’on arrête de croire en Lui
 qu’on mange des fruits de saison
qu’on mange des fruits de saison
 qu’on boive des vins francs
qu’on boive des vins francs
 que le ciel soit tantôt bleu, tantôt chargé de nuages de pluie, et qu’il cesse de nous jouer les paresseux
bloqué trop longtemps sur l’un ou l’autre
que le ciel soit tantôt bleu, tantôt chargé de nuages de pluie, et qu’il cesse de nous jouer les paresseux
bloqué trop longtemps sur l’un ou l’autre
 que les rivières soient claires et poissonneuses
que les rivières soient claires et poissonneuses
 que les ministres de la justice soient des garants du droit
que les ministres de la justice soient des garants du droit
 qu’on en finisse avec le système éditorial qui vend du mauvais bec à la pelle
qu’on en finisse avec le système éditorial qui vend du mauvais bec à la pelle
 que les ouragans retiennent leur souffle, et qu’on les aide à le faire en respectant un peu mieux notre
que les ouragans retiennent leur souffle, et qu’on les aide à le faire en respectant un peu mieux notre
planète
 que les artistes ne soient pas submergés par les médiateurs culturels
que les artistes ne soient pas submergés par les médiateurs culturels
 que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
 que les maladies incurables deviennent curables
que les maladies incurables deviennent curables
 que l’argent soit remis à sa place, qui n’est pas la première
que l’argent soit remis à sa place, qui n’est pas la première
 que l’ultra-libéralisme crève enfin sa bulle
que l’ultra-libéralisme crève enfin sa bulle
 que chacun se sente responsable de la beauté du monde
que chacun se sente responsable de la beauté du monde
 que la politique ne soit pas encombrée par d’obsédantes ambitions personnelles
que la politique ne soit pas encombrée par d’obsédantes ambitions personnelles
 que Paris soit interdite aux automobiles
que Paris soit interdite aux automobiles
 que le ministre de l’intérieur aille voir dehors si j’y suis, et y reste si je n’y suis pas
que le ministre de l’intérieur aille voir dehors si j’y suis, et y reste si je n’y suis pas
 que l’art dit conceptuel ne fasse plus comme s’il était ceptuel, et se contente d’être ce qu’il est
que l’art dit conceptuel ne fasse plus comme s’il était ceptuel, et se contente d’être ce qu’il est
 que l’Afrique en finisse avec ses malheurs, ceux qu’elle subit et ceux qu’elle s’ingénie à s’infliger à elle-même
que l’Afrique en finisse avec ses malheurs, ceux qu’elle subit et ceux qu’elle s’ingénie à s’infliger à elle-même
 que les poissons repeuplent les mers, et que les Japonais arrêtent de racler le fond des océans
que les poissons repeuplent les mers, et que les Japonais arrêtent de racler le fond des océans
 que les États-Unis d’Amérique en finissent avec leur infantilisme religieux
que les États-Unis d’Amérique en finissent avec leur infantilisme religieux
 que nous sachions de nouveau nous arrêter pour respirer une fleur et écouter un oiseau chanter
que nous sachions de nouveau nous arrêter pour respirer une fleur et écouter un oiseau chanter
 que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
 que le tourisme soit contingenté pour qu’il arrête de massacrer les plus beaux sites du monde
que le tourisme soit contingenté pour qu’il arrête de massacrer les plus beaux sites du monde
 que les entreprises ne soient plus des fabriques de stress et oublient d’exploiter leurs salariés
que les entreprises ne soient plus des fabriques de stress et oublient d’exploiter leurs salariés
 que la poésie recommence à parler au plus grand nombre
que la poésie recommence à parler au plus grand nombre
 qu’on redécouvre Pierre Louÿs et Marcel Aymé
qu’on redécouvre Pierre Louÿs et Marcel Aymé
 que l’Europe ne soit plus celle des ultra-libéraux et des bureaucrates
que l’Europe ne soit plus celle des ultra-libéraux et des bureaucrates
 qu’on accroche enfin quelque part la Divina Tragedia de Chenavard
qu’on accroche enfin quelque part la Divina Tragedia de Chenavard
 que toute l’agriculture soit bio et que les paysans arrêtent de tuer la terre
que toute l’agriculture soit bio et que les paysans arrêtent de tuer la terre
 que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
La liste est ouverte. A chacun d’y ajouter ses petits cailloux...
que tous ceux qui veulent travailler aient du travail
La liste est ouverte. A chacun d’y ajouter ses petits cailloux...
Philippe PUJAS - 2005